Responsable : Gisèle Bonne
Les thèmes de recherche de l’équipe se concentrent sur 2 groupes de maladies neuromusculaires (MNM) : les myopathies dues aux anomalies de la Myomatrice [collagène de type VI & maladies de la matrice extracellulaire (Allamand et al. 2011, Skelet Muscle; groupe de V Allamand] et du Myonucleus [dystrophie musculaire d’Emery-Dreifuss (EDMD) & autres laminopathies du muscle strié (SML)) dues aux mutations du gène LMNA codant pour des lamines de type A ou des gènes codant pour des composants liés à la membrane nucléaire (Bertrand et al. 2011, Biochem Soc Trans.; Azibani et al. 2014, Semin Cell Dev Biol; Groupe de G Bonne/ AT Bertrand)]. Ces myopathies présentant des rétractions importantes partagent certaines caractéristiques cliniques et peuvent faire l’objet d’un diagnostic différentiel.
Ces pathologies sont très hétérogènes, à la fois cliniquement et génétiquement, et aucun traitement n’est encore disponible. Nos activités antérieures ont conduit à l’identification d’anomalies génétiques, au développement d’outils (modèles cellulaires et animaux) et au décryptage des mécanismes physiopathologiques pour une meilleure compréhension des bases moléculaires et l’identification de cibles thérapeutiques. De nombreux problèmes restent non résolus: 1) l’absence de diagnostic moléculaire pour un sous-ensemble de patients, 2) la fonction précise des protéines impliquées et les mécanismes physiopathologiques sous-jacents… Plusieurs points communs (dysfonctionnement contractile, défauts de la mécanobiologie, fibrose…) ont été et sont toujours abordés de manière transversale par la mise en commun de nos compétences spécifiques (enveloppe nucléaire, nucléoplasme, matrice extracellulaire…).
Le projet de l’équipe s’articule autour de 3 axes
1. définir le spectre génétique et clinique ainsi que l’histoire naturelle de ces MNM ;
2. étudier les mécanismes physiopathologiques des mutations géniques qui induisent ces affections des muscles cardiaques et / ou squelettiques avec pour objectif :
3. identifier et de tester des pistes thérapeutiques pour ces affections. Ceci est effectué sur du matériel biologique provenant de patients (ADN, ARN, cellules en culture et biopsies) ainsi que sur les divers modèles animaux que nous avons développés.
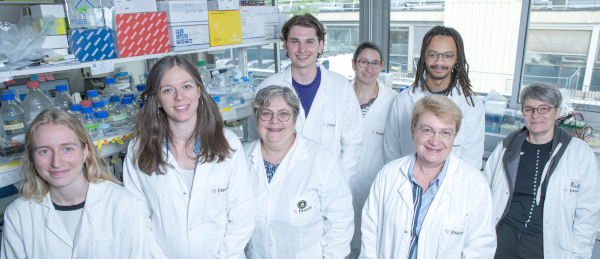
Axes de projets
- Spectre clinique et génétique des maladies liées à la Myomatrix et au Myonucleus : à l’aide de techniques de séquençage nouvelle génération (WES, WGS, RNA-seq) nous poursuivons l’identification de nouveaux gènes et variants pour les patients orphelins du diagnostic moléculaire en interaction étroite avec le Centre de références pour les MNM Paris-Nord/Est/Ile de France (B Eymard), le réseau Filnemus, l’ERN Euro-NMD ainsi que le consortium européen Solve RD (H2020 grant 2018-2022). Le but de cet axe est finalement de transférer les connaissances acquises vers des procédures de diagnostic dans des laboratoires de référence (par exemple l’unité fonctionnelle de Cardio-& Myogénétique, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière; le laboratoire de Biochimie et & de Génétique moléculaire, Institut Cochin).
- Histoire naturelle de ces maladies via des registres de patients nationaux et internationaux : nous élargissons encore le recrutement / l’inclusion de patients dans des registres nationaux et internationaux et explorons de manière approfondie l’histoire naturelle de notre maladie d’intérêt afin d’identifier les résultats de diagnostic et de pronostic et les biomarqueurs.
- Décrypter la structure et la fonction de la Myomatrix et du Myonucleus en santé et en maladie : en utilisant les différents modèles cellulaires et animaux disponibles ainsi que de nouveaux modèles, le cas échéant, nous avons pour objectif de décrypter plus avant la structure et la fonction des protéines actuellement connues, mais aussi des nouveaux candidats identifiés par nos investigations, à savoir les lamines de type A et les composants de l’enveloppe nucléaire associés, le collagène VI et les composants de la matrice extracellulaire associés. En particulier, les voies de signalisation et les mécanismes moléculaires pathologiques sont étudiés afin d’identifier des cibles thérapeutiques pertinentes et innovantes.
Ces différents axes de recherche, à visée translationnelle avec des bénéfices pour le patient, nous permettent d’identifier et de caractériser de nouveaux gènes, des spectres phénotypiques, des mécanismes pathologiques associés et des cibles thérapeutiques.